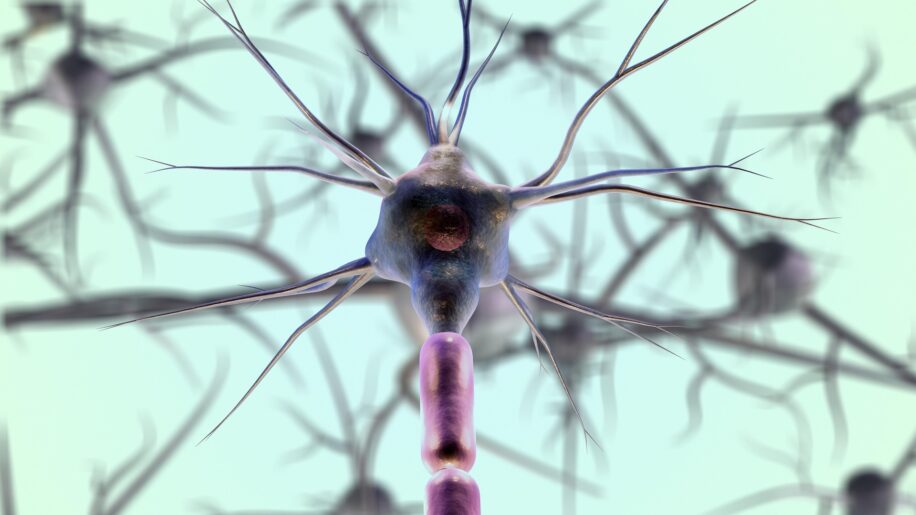La maladie d’Alzheimer figure parmi les affections neurodégénératives les plus fréquentes et dévastatrices. Bien que son origine soit généralement considérée comme étant liée à l’accumulation de peptides bêta-amyloïdes et à l’interaction de la protéine tau avec ces derniers, la cause fondamentale de cette pathologie demeure encore floue. Récemment, une étude menée par des chercheurs américains suggère une nouvelle hypothèse visant à expliquer les désordres moléculaires associés à Alzheimer. Selon l’équipe, la pathologie pourrait être déclenchée par ce qu’ils appellent des « granules de stress chronique », qui altèrent l’activité génétique et perturbent la communication entre les cellules cérébrales.
La maladie d’Alzheimer se distingue non seulement par sa prévalence, mais aussi par son impact dévastateur sur les fonctions cognitives, allant de la perte de mémoire au déclin intellectuel profond. La complexité de cette maladie a longtemps entravé les efforts des chercheurs pour en déterminer les causes précises.
Sur le plan thérapeutique, les médicaments actuellement disponibles se concentrent principalement sur le soulagement des symptômes, le ralentissement de la progression de la maladie et la gestion des troubles cognitifs. Les approches thérapeutiques ciblées, telles que les anticorps anti-amyloïdes, rencontrent cependant des limitations majeures, notamment en raison de la barrière hémato-encéphalique (BHE), qui restreint l’accès des molécules thérapeutiques au cerveau.
Des chercheurs de l’hôpital universitaire Anam, en Corée, ont récemment proposé une alternative innovante en explorant l’utilisation d’ultrasons focalisés pour réduire les plaques amyloïdes. Cette technique non invasive a donné des résultats préliminaires prometteurs, bien que des études cliniques à plus grande échelle soient nécessaires pour évaluer pleinement son efficacité et sa sécurité sur des populations plus diversifiées.
Vers un modèle unifié de la maladie d’Alzheimer ?
Historiquement, les recherches sur la maladie d’Alzheimer se sont concentrées sur plusieurs hypothèses : l’accumulation de plaques amyloïdes, les enchevêtrements de protéines tau, l’inflammation cérébrale ainsi que des dysfonctionnements mitochondriaux et cellulaires.
Cependant, aucune de ces théories n’a permis d’intégrer de manière cohérente l’ensemble des anomalies observées dans la maladie. C’est dans ce contexte qu’une équipe de chercheurs du Biodesign Institute de l’Université d’État de l’Arizona a orienté ses travaux vers un modèle théorique capable de concilier ces différentes observations.
« Notre proposition, qui se concentre sur la rupture de la communication entre le noyau et le cytoplasme, conduisant à des perturbations massives de l’expression des gènes, offre un cadre plausible pour expliquer de manière exhaustive les mécanismes à l’origine de cette maladie complexe », explique Paul Coleman, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.
Selon Coleman et ses collègues du Centre de recherche sur les maladies neurodégénératives de l’ASU-Banner, la maladie d’Alzheimer induit des modifications profondes de l’expression des gènes. Cette altération de l’expression des gènes accroît le stress cellulaire, entrave la communication entre les neurones et provoque des anomalies protéiques, notamment des dépôts bêta-amyloïdes.
Pour approfondir leur hypothèse, les chercheurs ont analysé des données issues de diverses bases de santé, en les croisant avec des études antérieures, dont une recherche clé de 2022 portant sur l’évolution de la maladie. Leur objectif : identifier les altérations généralisées de l’expression des gènes associés à cette pathologie. Ce processus, essentiel à la production des protéines nécessaires au bon fonctionnement cellulaire, est gravement perturbé dans le contexte de la maladie d’Alzheimer.
Granules de stress : un rôle central dans la neurodégénérescence
Leurs analyses suggèrent que ces modifications génétiques pourraient résulter d’un dysfonctionnement du système de transport des molécules essentielles entre le noyau cellulaire et le cytoplasme. Cette perturbation, qui affecterait plus de 1 000 gènes, engendre des dysfonctionnements synaptiques, des altérations métaboliques et des phénomènes de neurodégénérescence, à l’origine des symptômes caractéristiques de la maladie : troubles de la mémoire, déclin cognitif, neuroinflammation ainsi que la formation d’enchevêtrements de protéines tau.
L’équipe de recherche met ainsi en lumière un acteur clé de ce processus : les granules de stress chroniques. Il s’agit d’accumulations de protéines et d’ARN qui se forment en réponse à des situations de stress cellulaire aigu. Normalement, ces structures sont temporaires et servent à suspendre des processus cellulaires non essentiels pour permettre à la cellule de retrouver son équilibre. Toutefois, dans le cadre de la maladie d’Alzheimer, ces granules persistent de manière anormale, perturbant des mécanismes fondamentaux, notamment le transport entre le noyau et le cytoplasme des cellules.
Les chercheurs suggèrent que toutes les manifestations de la maladie pourraient découler de cette origine commune. Bien qu’aucune preuve définitive n’ait encore été apportée, cette hypothèse est appuyée par des observations issues de travaux antérieurs. De plus, le fait que le stress cellulaire apparaisse avant l’émergence des symptômes cliniques pourrait permettre d’envisager des interventions précoces, visant à freiner l’évolution de la maladie dès ses premiers stades.
« Notre étude contribue au débat actuel sur le moment où la maladie d’Alzheimer commence réellement – un concept en constante évolution, façonné par les progrès de la technologie et de la recherche », souligne Coleman. « Les questions clés sont de savoir quand la maladie peut être détectée pour la première fois et à quel moment l’intervention doit débuter, deux enjeux importants pour les futures approches médicales ».