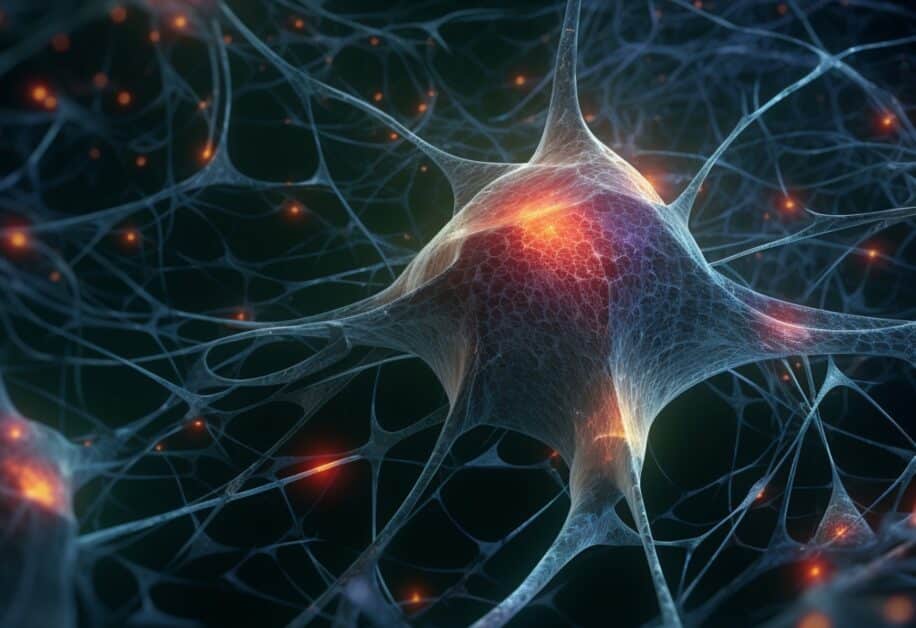La dégénérescence des neurones dopaminergiques est largement acceptée comme étant le facteur déclenchant la maladie de Parkinson. Cependant, une nouvelle étude révèle un déclencheur bien plus précoce : le dysfonctionnement synaptique dû à la mutation d’un gène appelé « parkine », entraînant un déficit de dopamine. Ce processus, jusqu’ici inconnu, pourrait permettre d’intervenir beaucoup plus tôt, avant que ne survienne la neurodégénérescence.
Affectant 1 à 2% de la population, la maladie de Parkinson se caractérise par des tremblements au repos, une rigidité et une bradykinésie (lenteur des mouvements). Ces symptômes sont dus à la perte progressive des neurones dopaminergiques, au niveau du mésencéphale. L’étude des formes génétiques de la maladie a permis de mettre en lumière plusieurs mécanismes potentiels impliqués dans la neurodégénérescence dopaminergique. Cependant, la manière dont les gènes sont impliqués demeurait jusqu’ici mystérieuse.
Une cascade toxique conduisant à la neurodégénérescence
Il y a peu dans le cadre d’une autre étude, des chercheurs ont identifié une cascade toxique déclenchée par un dysfonctionnement mitochondrial et lysosomal chez les patients souffrant de la maladie. Cette réaction est enclenchée par une accumulation d’une forme oxydée de la dopamine et de la protéine alpha-synucléine. L’augmentation de la dopamine oxydée réduit notamment l’activité de la glucocérébrosidase lysosomale (GCase), une enzyme impliquée dans la maladie de Parkinson. Cette diminution affaiblit à son tour la fonction lysosomale et aboutit à la neurodégénérescence. La dopamine toxique endommage également les mitochondries en augmentant le stress oxydatif, ce qui crée un cercle vicieux exacerbant les niveaux de dopamine oxydée.
En temps normal, les mitochondries endommagées ou trop âgées sont recyclées selon un phénomène appelé mitophagie. Elles sont en quelque sorte absorbées en même temps que les vésicules synaptiques défectueuses, puis digérées par les lysosomes. Ce processus est amorcé par le gène PINK1, activant le gène producteur de la parkine (une enzyme). Dans les formes génétiques de Parkinson, ces gènes mutent et dérégulent ainsi la fonction lysosomale. Des molécules toxiques sont alors accumulées au niveau des neurones.
Cependant, l’on ne savait pas jusqu’ici si le gène de la parkine pouvait être activé en l’absence de PINK1, ni comment cette activation contribue exactement à la pathogenèse de la maladie. En effet, deux cas de Parkinson particulièrement intriguants ont soulevé des questions concernant la véritable implication de ces gènes. Faisant l’objet d’une enquête approfondie dans la nouvelle étude, parue dans la revue Neuron, ces cas ont permis de découvrir un processus jusqu’ici méconnu. À noter que l’étude a porté sur les neurones du mésencéphale des patients, car les neurones dopaminergiques des modèles murins fonctionnent différemment de ceux des humains.
Un déclencheur précoce de la maladie
Les patientes étudiées sont deux sœurs dépourvues du gène PINK1 depuis la naissance, ce qui les exposait à un risque élevé de développer Parkinson. Cependant, de manière tout à fait surprenante, l’une a présenté ses symptômes à l’âge de 16 ans tandis que l’autre a été diagnostiquée seulement à 49 ans. En effet, bien qu’elles soient toutes deux dépourvues de PINK1, la première présentait une mutation hétérozygote du gène de la parkine. C’est-à-dire que contrairement à sa sœur, sa perte du gène de la parkine est partielle. En toute logique, cela ne devrait pas suffire à déclencher la maladie. « Il doit y avoir une perte totale de parkine pour provoquer la maladie de Parkinson. Alors, pourquoi la sœur qui n’a perdu que partiellement la parkine a-t-elle contracté la maladie plus de 30 ans plus tôt ? ». C’est ce que se demandait l’un des auteurs de la recherche, Dimitri Krainc, de l’Université de Norhtwestern.
L’explication la plus probable est que le gène de la parkine peut s’activer indépendamment de PINK1 et régit une voie neurologique fondamentalement différente. « Nous avons découvert un nouveau mécanisme pour activer la parkine dans les neurones des patients », explique Krainc. En analysant les neurones des patients, les chercheurs ont en effet constaté que l’activité neuronale enclenchait une phosphorylation et une activation de la parkine, par la protéine kinase 2 dépendante de la calmoduline (CaMK2). Ce processus s’effectue indépendamment de PINK1. Ces résultats suggèrent qu’une voie indépendante de PINK1 permet au gène de la parkine de réguler l’endocytose (mitophagie et élimination des vésicules synaptiques) dans les neurones dopaminergiques. Cette voie est altérée lorsque le gène de la parkine mute et conduit à une accumulation de dopamine oxydée.
D’autre part, les chercheurs ont découvert une nouvelle voie de fonctionnement du gène, n’ayant aucun rapport avec sa fonction endocytaire. Il contrôle notamment la libération de la dopamine au niveau des terminaisons synaptiques. En cas de Parkinson, ces synapses deviennent dysfonctionnelles bien avant la survenue de la neurodégénérescence, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’une des sœurs a développé ses symptômes à l’âge de 16 ans en possédant une version partiellement mutante du gène. « Sur la base de ces résultats, nous émettons l’hypothèse que cibler les synapses dysfonctionnelles avant la dégénérescence des neurones pourrait représenter une meilleure stratégie thérapeutique », conclut Krainc.