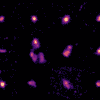La Terre aurait été incapable d’abriter la vie sans une collision majeure avec Théia, une protoplanète de la taille de Mars, il y a plus de 4 milliards d’années, suggère une nouvelle étude. La Terre primitive aurait notamment été située dans une région du système solaire où les températures étaient trop élevées pour condenser les composés volatils essentiels à l’émergence de la vie. Théia, qui se serait formée plus loin dans le système solaire, aurait alors apporté ces composés et permis à la vie terrestre de s’épanouir et d’évoluer.
Les processus d’évaporation et de condensation des solides dans le disque protoplanétaire constituent une étape essentielle à l’évolution du système solaire. Ces processus ont façonné la répartition des éléments constitutifs des planètes et ont probablement contribué à l’habitabilité de notre planète. Les astronomes estiment que la transition du disque protoplanétaire de la dissipation du gaz à la formation des corps solides rocheux s’est produit au cours des 3 à 5 premiers millions d’années du disque.
Au cours de cette étape de transition, le disque protoplanétaire était riche en composés volatils essentiels à l’émergence de la vie, tels que l’hydrogène, l’eau, le carbone et le soufre. Cependant, ces composés pouvaient difficilement exister dans le système solaire interne – la partie la plus proche du Soleil où se trouvent les planètes rocheuses – en raison des températures trop élevées. Ils ne se sont pas condensés et sont restés en grande partie à l’état gazeux. Cela signifie que les conditions de la Terre n’étaient pas propices à la vie lors de sa formation.
Étant donné que ces composés volatils ne sont pas incorporés aux matériaux rocheux à partir desquels les planètes se sont formées, la Terre primitive en contenait probablement très peu, voire pas du tout. Seules les planètes qui se sont formées plus loin, notamment les géantes gazeuses, étaient suffisamment froides pour pouvoir condenser ces éléments. Or, la Terre est actuellement la seule planète connue à abriter la vie depuis des milliards d’années.
Étant donné ses conditions primitives, la manière exacte dont la Terre a évolué pour pouvoir abriter la vie demeure en grande partie incomprise. Une étude dirigée par des chercheurs de l’Université de Berne, en Suisse, suggère que les composés volatils essentiels au processus ont été apportés sur Terre via une source externe importante comme une autre protoplanète qui s’est formée plus loin.
« La Terre ne doit pas son potentiel actuel d’accueil de la vie à une évolution continue, mais probablement à un événement fortuit : l’impact tardif d’un corps étranger riche en eau. Cela montre clairement que l’accueil de la vie dans l’Univers est loin d’être une évidence », explique dans un communiqué, Klaus Mezger, co-auteur et professeur émérite de géochimie à l’Institut des sciences géologiques de l’Université de Berne, en référence aux résultats de l’étude publiée dans la revue Science Advances.
Un tournant déterminant dans l’évolution de la Terre ?
Pour étayer leur hypothèse, les chercheurs ont effectué des simulations utilisant une combinaison de données isotopiques et élémentaires provenant de météorites et roches anciennes collectées sur Terre. Pour estimer leurs temps d’évolution, l’équipe s’est appuyée sur la désintégration radioactive du manganèse 53 en chrome 53.
Présent dans le système solaire primitif, cet isotope du manganèse se désintègre en chrome 53 avec une demi-vie de 3,8 millions d’années, permettant ainsi d’estimer l’âge de matériaux vieux de plusieurs milliards d’années avec une précision inférieure à un million d’années. La technique a permis d’obtenir une évaluation temporelle précise de l’évolution de la composition chimique de la Terre par rapport à d’autres éléments constitutifs planétaires.
Les résultats des simulations montrent que la structure chimique de la Terre primitive était déjà finalisée moins de 3 millions d’années après la formation du système solaire. « Notre Système solaire s’est formé il y a environ 4 568 millions d’années. Sachant qu’il n’a fallu que 3 millions d’années pour que la Terre acquière ses propriétés chimiques, ce résultat est étonnamment rapide », explique Pascal Kruttasch, auteur principal qui a réalisé l’étude lorsqu’il était doctorant à l’Université de Berne et qui est actuellement à l’Imperial College de Londres.
D’après l’équipe, ces résultats confirment l’hypothèse selon laquelle une collision ultérieure avec Théia a représenté un tournant déterminant dans l’évolution de la proto-Terre. S’il a fallu moins de 3 millions d’années à la Terre pour achever sa structure chimique, il aurait fallu un événement ultérieur pour l’apparition de conditions propices à la vie et Théia s’est formée probablement plus loin dans le système solaire pour accumuler des composés volatils comme l’eau.
« Grâce à nos résultats, nous savons que la proto-Terre était initialement une planète rocheuse et sèche. On peut donc supposer que seule la collision avec Théia a apporté des éléments volatils sur Terre et a finalement rendu la vie possible », explique Kruttasch. Ces résultats concordent en outre avec ceux d’une étude indépendante suggérant que la collision avec Théia est à l’origine d’une grande partie de l’eau accumulée dans le manteau de la Terre primitive.
À noter que la collision de la Terre primitive avec Théia est théorisée depuis des décennies, notamment dans le phénomène, surnommé « Grand impact », qui aurait donné naissance à la Lune. Toutefois, « jusqu’à présent, cette collision est insuffisamment comprise », souligne Kruttasch. « Il est nécessaire de disposer de modèles capables d’expliquer pleinement non seulement les propriétés physiques de la Terre et de la Lune, mais aussi leur composition chimique et leurs signatures isotopiques », conclut-il. Cela pourrait fournir davantage d’indices sur l’implication de la protoplanète dans l’émergence de la vie sur Terre.