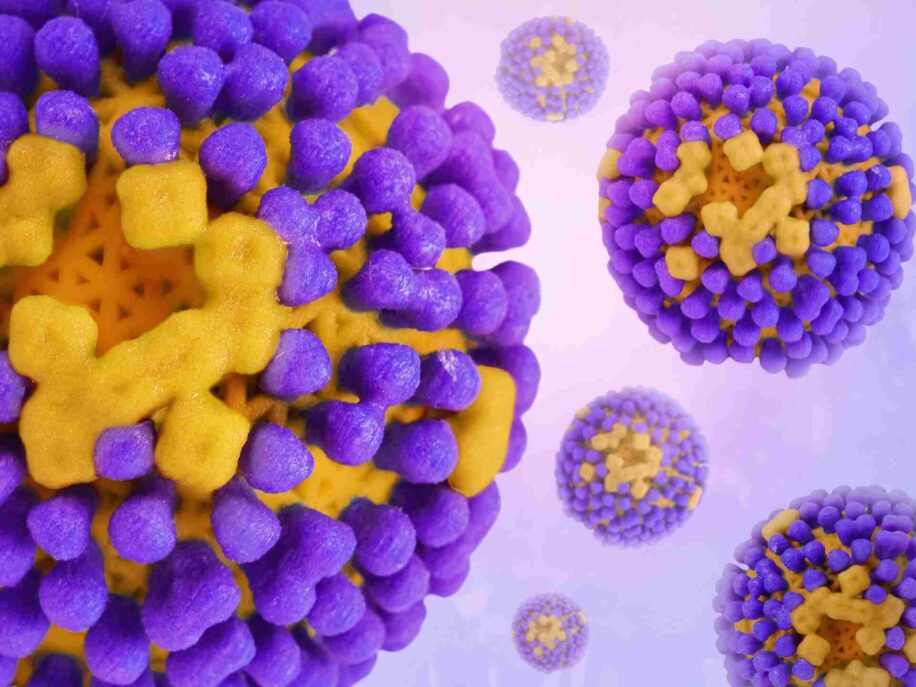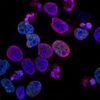Une étude révèle que le Covid long est associé à des troubles menstruels chez les femmes, notamment des saignements plus abondants et plus longs. Les patientes présentaient également une inflammation accrue de l’endomètre pendant leurs règles, et les symptômes de la maladie s’aggravaient à l’approche du cycle. Ces observations mettent en lumière une dimension encore peu explorée des effets de la maladie sur la santé des femmes.
Le Covid long est une affection complexe dont l’étiologie exacte et les conséquences sur la santé demeurent mal comprises. Selon la définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il se caractérise par des symptômes apparaissant trois mois après l’infection initiale au SARS-CoV-2 et persistant pendant au moins deux mois. Parmi les manifestations les plus fréquentes figurent la fatigue chronique, le brouillard cérébral, l’insomnie ou encore les douleurs musculaires.
Plusieurs mécanismes physiopathologiques ont été avancés pour expliquer la persistance de ces symptômes : la persistance du matériel viral ou sa réactivation, une dérégulation immunitaire, des lésions tissulaires permanentes, entre autres. Mais ni l’inventaire des symptômes ni celui des mécanismes sous-jacents ne sont à ce jour exhaustifs.
De récentes études observationnelles centrées sur la santé des femmes ont montré que la Covid-19 peut provoquer des troubles menstruels, allant de saignements douloureux et abondants à l’absence de menstruation, en passant par une modification de la durée des cycles. Les femmes atteintes de Covid long présentent plus fréquemment de telles perturbations.
Ces troubles peuvent affecter profondément la santé et la qualité de vie des patientes. Toutefois, la relation précise entre Covid long et cycle menstruel reste mal établie : la plupart des travaux se limitaient jusqu’ici à des cohortes de femmes infectées, sans comparaison avec des groupes témoins.
Une étude codirigée par l’université d’Édimbourg entend combler ces lacunes en examinant si la Covid est associée à des saignements utérins anormaux, si les symptômes du Covid long varient selon les phases du cycle menstruel et quels mécanismes biologiques pourraient en être responsables. Ces résultats pourraient aider à mieux adapter les approches thérapeutiques destinées aux femmes.
Une relation bidirectionnelle entre le Covid long et les troubles menstruels
Pour leur enquête, les chercheurs ont recruté 12 787 femmes au Royaume-Uni : 1 048 souffrant de Covid long, 1 716 ayant contracté la Covid aiguë et s’étant rétablies, et 9 423 témoins. Les cycles menstruels de ces participantes ont été analysés, de même que l’évolution individuelle des symptômes du Covid long au fil des cycles chez 54 patientes.
Les résultats montrent que les femmes atteintes de Covid long connaissent des menstruations plus longues et plus abondantes, ainsi que des saignements intermenstruels. Celles ayant contracté la Covid aiguë n’ont présenté que des perturbations minimes. Les symptômes du Covid long s’intensifiaient en outre durant la phase périmenstruelle, soit les deux jours précédant et suivant les règles. Ces résultats suggèrent une relation bidirectionnelle entre la maladie et les troubles menstruels.
Dans un second temps, dix patientes et dix témoins ont été suivis pour évaluer l’impact du Covid long sur la fonction ovarienne et endométriale. Les analyses indiquent que la maladie est associée à une perturbation de la régulation des hormones androgènes — précurseurs des œstrogènes — ainsi qu’à une inflammation de l’endomètre.
« Le profil des cytokines sériques a révélé une inflammation menstruelle accrue chez les patientes atteintes de Covid long, et des agrégats de cellules immunitaires ont été observés dans l’endomètre menstruel », expliquent les auteurs dans leur étude publiée dans la revue Nature Communications. Globalement, les données montrent que le Covid long est associé à des perturbations menstruelles, sans entraîner de perte significative de la fonction ovarienne.
Les chercheurs soulignent néanmoins les limites de leur travail : la taille restreinte de certaines cohortes et le manque de diversité des participantes. Ces résultats ne permettent donc pas d’établir une corrélation définitive. Outre l’infection elle-même, ces troubles pourraient également être liés à la vaccination et/ou au stress associé à la persistance de la maladie. Les prochaines études devront prendre en compte ces facteurs et s’appuyer sur des cohortes plus larges et plus diversifiées.