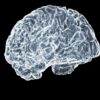Un nouveau test sanguin basé sur des marqueurs épigénétiques pourrait permettre de diagnostiquer le syndrome de fatigue chronique avec une précision de 96 %. Le test aurait permis d’identifier un profil épigénétique spécifique chez les personnes atteintes, ouvrant la voie à une meilleure prise en charge précoce. Les résultats pourraient également contribuer, à terme, au diagnostic de maladies présentant des symptômes similaires, comme le Covid long.
Le syndrome de fatigue chronique (ou encéphalomyélite myalgique – l’EM/SFC) est une affection invalidante qui toucherait plus de 20 millions de personnes dans le monde. Cette maladie multifactorielle se caractérise par une fatigue intense non soulagée par le repos, des malaises post-efforts, des troubles cognitifs persistants – souvent qualifiés de « brouillard cérébral » – ainsi que des difficultés à accomplir les tâches quotidiennes.
Le syndrome de fatigue chronique n’a cependant été reconnu comme une véritable maladie que relativement récemment, et aucun consensus n’existe encore sur ses causes exactes. Les symptômes, très variables d’un patient à l’autre, rendent le diagnostic difficile, celui-ci reposant principalement sur l’évaluation clinique.
« L’EM/SFC est une maladie grave et souvent invalidante, marquée par une fatigue extrême qui n’est pas soulagée par le repos. Nous savons que certains patients disent être ignorés, voire accusés d’imaginer leur maladie », explique dans un billet de blog de l’Université d’East Anglia (UEA), en Angleterre, Dmitry Pshezhetskiy, de la faculté de médecine de Norwich. « En l’absence de tests définitifs, de nombreux patients ne sont pas diagnostiqués ou le sont à tort pendant des années », ajoute-t-il.
Vers un test sanguin enfin fiable pour une maladie longtemps ignorée ?
Pour pallier ces difficultés, Pshezhetskiy et son équipe ont développé un nouveau test sanguin qui offrirait une précision nettement supérieure à celle des méthodes actuelles. « Notre découverte ouvre la possibilité d’un test sanguin simple et précis pour confirmer un diagnostic, ce qui pourrait permettre une prise en charge plus précoce et une gestion plus efficace », souligne le chercheur.
Jusqu’ici, la recherche sur des tests diagnostiques rapides pour l’EM/SFC s’était concentrée sur des marqueurs moléculaires – métaboliques ou inflammatoires – révélant notamment des profils altérés de cytokines et un dysfonctionnement des cellules tueuses naturelles (« natural killers »), un type de cellule immunitaire.
Cependant, « malgré ces avancées, les chercheurs n’ont pas encore établi d’outils diagnostiques objectifs ni élucidé les mécanismes physiopathologiques », précisent Pshezhetskiy et ses collègues dans leur étude parue dans le Journal of Translational Medicine. L’équipe propose plutôt d’utiliser la technologie EpiSwitch® 3D Genomics d’Oxford BioDynamics (OBD), fondée sur l’analyse de marqueurs épigénétiques.
Si le code génétique reste stable tout au long de la vie, l’épigénome, lui, évolue sous l’influence de l’environnement et des maladies. « Le syndrome de fatigue chronique n’est pas une maladie génétique congénitale. C’est pourquoi l’utilisation des marqueurs épigénétiques EpiSwitch – qui varient au cours de la vie, contrairement au code génétique fixe – s’est révélée essentielle pour atteindre un haut niveau de précision », explique Alexandre Akoulitchev, directeur scientifique d’OBD et coauteur de l’étude.
Une empreinte épigénétique spécifique
La technologie EpiSwitch avait déjà démontré son efficacité dans la détection de marqueurs sanguins associés à des maladies inflammatoires et neurologiques complexes, telles que la sclérose latérale amyotrophique, la polyarthrite rhumatoïde ou certains cancers. Le test EpiSwitch PSE, destiné au diagnostic du cancer de la prostate, est d’ailleurs déjà utilisé au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Pour évaluer cette technologie dans le cadre de l’EM/SFC, les chercheurs ont recruté 47 patients atteints d’EM/SFC sévère et 61 témoins sains. L’équipe a constaté un profil épigénétique spécifique apparaissant systématiquement chez les personnes malades, absent chez les témoins.
Le test a montré une précision de 96 %, avec une sensibilité de 92 % et une spécificité de 98 %. La sensibilité indique la proportion de cas positifs correctement identifiés, tandis que la spécificité mesure la capacité du test à exclure les personnes non atteintes.
Les chercheurs ont également mis en évidence certaines voies immunitaires et inflammatoires particulières. « La compréhension des mécanismes biologiques impliqués dans l’EM/SFC ouvre la voie au développement de traitements ciblés et à l’identification des patients susceptibles de mieux répondre à certaines thérapies », avance Pshezhetskiy.
Des résultats encourageants, mais encore à consolider
À noter toutefois que, malgré le taux de précision obtenu, la technique comporte des limites, la première étant que les résultats proviennent d’une cohorte relativement restreinte. Un test sanguin doit en outre être à la fois très sensible et hautement spécifique à la maladie étudiée. L’étude ne permet pas encore de déterminer si le profil épigénétique repéré est également présent aux tout premiers stades de l’EM/SFC ou chez les personnes atteintes de formes plus légères et anciennes.
Par ailleurs, « nous devons aussi savoir si cette anomalie, absente chez les témoins sains, ne se retrouve pas dans d’autres maladies inflammatoires chroniques et auto-immunes présentant des symptômes similaires à ceux de l’EM/SFC », souligne Charles Shepherd, conseiller médical de la ME Association, cité par le Guardian.
L’équipe de recherche voit toutefois dans cette proximité symptomatique un atout. Des affections comme le Covid long présentent des manifestations comparables à celles de l’EM/SFC. Les chercheurs suggèrent que la technique pourrait donc aussi ouvrir la voie à un test sanguin fiable pour diagnostiquer cette maladie.